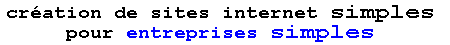

(petite) Histoire
L'histoire de l'informatique
est encore jeune, à peine plus de la cinquantaine...
Ne parlons même pas des réseaux de données qui
n'existent que depuis 1969.
Peut-on vraiment parler d'histoire sans le recul nécessaire ?
---------
* produits
* philosophie
* coûts et prix
* déroulement
* support
* maintenance
---------
* définitions
* histoire
* chronologie
* Mondrian
---------
* liens
---------
* contact
Les prémices
Les premières machines nommées "ordinateurs" sont fabriquées dans les années 1950. Ces machines permettent d'effectuer d'importants calculs, et sont développées dans le but de gagner du temps.
En 1957, le succès de l'Union Soviétique dans le mise en orbite du Spoutnik déclenche la création de l'Advanced Research Projects Agency (ARPA) par le Department of Defense (DoD) aux Etats-Unis.
L'objectif de mettre en oeuvre des réseaux de données part d'une idée claire dans l'esprit des militaires américains : dans un contexte de fortes tensions internationales, il faut pouvoir stocker des données stratégiques à différents endroits.
Plusieurs ouvrages traitant de théories des communications en réseau sont publiés aux début des années 1960.
Une première liaison entre deux machines est mise en place en 1965 d'un bout à l'autre des Etats-Unis, entre le MIT (Massachusetts Institute of Technology) et Santa Monica, Californie, utilisant une liaison téléphonique dédiée sur plus de 10000 kilomètres.
Le premier réseau à commutation de paquets voit le jour
en 1969, sous la tutelle de l'ARPA ; il est donc baptisé ARPANET.
Il comporte quatre noeuds : University of California Los Angeles (UCLA),
Stanford Research Institute (California), University of California
Santa Barbara (UCSB), University of Utah.
Cette année voit aussi la publication du premier Request
For Comments (RFC) : Host Software.
Construction des réseaux
Le succès d'ARPANET entraine le raccordement de nombreux hôtes sur ce réseau. D'autre part, plusieurs réseaux voient le jour aux Etats-Unis, en Europe, au Japon, sur la même base technique qu'ARPANET : la commutation de paquets.
Ces réseaux sont souvent des initiatives de scientifiques et d'universitaires, qui voient en eux une application bénéfique à tous : le partage des informations. Le nombre d'hôtes sur les réseaux augmente fortement, et rapidement se pose le problème de l'interconnexion de ces différents réseaux : tous utilisent des protocoles de communications mis en place indépendamment, et qui sont souvent différents.
En 1974, un protocole est proposé pour l'interconnexion des réseaux : les spécifications de TCP (Transport Control Protocol) sont détaillées dans la publication de Vint Cerf et Bob Kahn, A Protocol for Packet Network Interconnection. En 1978, TCP est divisé en TCP / IP, Internet Protocol est né ; cette suite de protocoles doit maintenant être implantée (ou implémentée) sur tous les réseaux pour pouvoir fonctionner, et permettre leur interconnexion.
Il reigne à cette époque une certaine effervescence dans les milieux scientifiques autour des réseaux de données, et de nombreuses rencontres et colloques sont organisés sur le sujet ; de nombreuses organisations voient le jour autour de certaines idées, qui dureront plus ou moins dans le temps.
ARPANET, qui reste le principal réseau, adopte la suite de protocoles TCP / IP comme standard en 1982, et crée ainsi le premier "internet" dans le sens de réseaux interconnectés (Internet <=> Interconnect[ ed | ing ] Networks). Petit à petit, des réseaux, jusqu'alors distincts, adoptent cette suite de protocoles pour ne former qu'un seul grand réseau de réseaux interconnectés : Internet.
L'explosion d'Internet
Depuis la naissance des réseaux à commutation de paquets dans les années 1970, de nombreux protocoles ont vu le jour afin de mettre en place des services sur les machines reliées au réseau. Nombre de ces services étaient destinés à la communication et le partage des informations : terminal distant, transfert de fichier, forum, système de nom de domaine, courrier, conversation instantanée, etc.
Le courrier électronique était parmi le plus utilisé, et il contribua fortement au succès de ce nouvel outil de communication qu'est un réseau mondial.
Mais en 1990, la création d'un service va révolutionner les usages de ce réseau, et a fortiori, de l'ensemble des pays riches de la planète. Les spécifications du World Wide Web sont publiées au CERN à Genève par Tim Berner Lee, qui travaille depuis un moment sur un projet de liens hypertexte. Ces liens sont créés entre des pages de texte, et améliorent considérablement les possibilités de visualisation des documents, qui deviennent accessibles à partir de programmes baptisés "browsers" (navigateur en français, vous en utilisez un en ce moment).
L'intérêt commercial de ce service est rapidement compris. De nombreuses entreprises naissent pour proposer aux autres acteurs économiques des solutions de communication sur le web. La demande est très forte, et l'offre insuffisante et souvent peu compétente, mais peu importe, les enjeux sont trop importants, et intégrer cet outil devient une obligation commerciale.
La suite a été largement médiatisée, et par conséquent, est un peu moins mystérieuse...
Le milieu des années 1990 marque le début d'une importante vague d'euphorie des investisseurs financiers autour de ces entreprises de la "nouvelle économie". Les perspectives de croissance des activités liées au web sont de l'ordre de 50 à 100% par an. Les sommes d'argent à gagner par la spéculation financière (10 ans après la libéralisation des marchés financiers) sont astronomiques, et aveuglent complètement les acteurs des marchés. Les indices boursiers montent, montent, les valeurs des actions deviennent démesurées, les entreprises concernées ont parfois même trop d'argent à investir...
Mais comme tout à une fin, les marchés
financiers finissent par s'effondrer. Les investisseurs se rendent compte que
la croissance du web n'est pas aussi phénoménale que prévu,
et retirent leurs fonds. Nous sommes en l'an 2000, et c'est l'explosion de
la "bulle Internet".
Pendant plus d'un an, les valeurs boursières chutent.
Suivent les faillites,
plans sociaux et licenciements pour de nombreuses entreprises, autant dans les
jeunes entreprises de la "nouvelle économie" que dans les
industries, constructeurs, opérateurs traditionnels
des télécoms, de la micro-électronique, de
l'informatique.
Comment conclure cet historique ?
L'histoire est tellement
récente que la prise de parti est inévitable, d'autant plus
que j'ai été touché de très près par
cette "histoire", et qu'elle me concerne encore aujourd'hui.
La première réaction constatée à la
suite de ce phénomène "économique" a
été le rejet en bloc du web, et la remise en cause
d'Internet et de son utilité.
Heureusement, il n'a pas fallu trop longtemps pour que l'on
s'aperçoive que la "machine" était déjà
lancée, et qu'il était inutile, voire stupide, de la
rejeter.
Dans les faits, le taux d'équipement en matériel informatique n'a
pas cessé d'augmenter, de même que le nombre de personnes
consultant Internet de façon régulière.
La question qu'il vaut mieux se poser
maintenant, à tête reposée, une fois passée
l'euphorie de l'appât du gain, serait plutôt :
COMMENT INTEGRER CET OUTIL SURPUISSANT DE MANIERE ADAPTEE ?
en prenant en compte les nombreux critères qui le composent,
notamment qualité et accessibilité.
Références
- Hobbes' Internet Timeline :
http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/ - Mission "Développement Technique de l'Internet"
de l'Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique (INRIA)
http://mission-dti.inria.fr
contact : Julien Cacheux
courrier électronique : julien.cacheuxATfree.fr (AT > @)
tel. : 05 34 31 50 94



MAJ : 2004-04-25